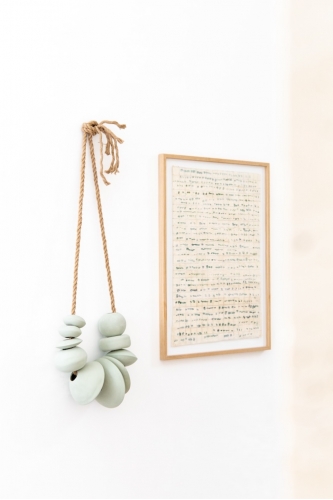Expositions
Voir plus
EXPOSITIONS PASSÉES

Jeux Croisés
Laure Carré & Kees Van de Wal
Septembre - octobre 2024
Laure carré Un fil existe, bien visible, qui, au sein de l’œuvre qu’elle construit, relie les unes aux autres les expositions dans lesquelles Laure Carré présente la succession de ses dessins, de ses tableaux, de ses images. Mais ce fil prend l’apparence aussi d’une corde ou d’un lasso que les personnages qu’elle peint se passeraient de main en main. L’an dernier, il s’agissait de boxeurs. Aujourd’hui, ce sont des cowboys. La ressemblance est frappante. Les mêmes silhouettes flottent sur les fonds colorés dont elles se détachent ou à l’in_térieur desquels elles se dissolvent, elles lévitent dans le vide, suspendues dans l’air au sein duquel on dirait qu’elles dansent, sautant à la corde mais faisant également de la corde qui tourne autour de leur corps un lasso lancé vers le ciel afin d’y capturer l’apparence d’un rêve. Le ring à la surface duquel se déroulait la chorégraphie d’un combat se métamorphose et il cède la place à un espace plus vaste qui prend maintenant les dimensions du grand Ouest américain, du Farwest.
Une autre mythologie se manifeste : des montagnes et des canyons, des cavaliers et leurs montures, réminiscences des westerns avec leurs numéros de rodéos ou leurs duels au revolver et le « poor lonesome cowboy », seul dans un lointain que la peinture nous rend pourtant si proche. Je dis « mythologie » car rien n’est moins réaliste que le traitement que l’artiste réserve à son sujet. Elle nous offre des images d’images parmi lesquelles chacun reconnaîtra celles qui nous viennent du cinéma américain et de la culture populaire. Mais par le tour même qui appartient en propre à la vraie peinture, Laure Carré leur restitue la vérité native qui, soudain, leur donne leur valeur nouvelle.
L’Ouest américain, sans y avoir forcément mis les pieds – et d’ailleurs je pense qu’il n’existe plus-, on croit le connaître. Cependant, l’artiste nous le rend comme on l’avait rarement vu. Il y a peu d’indiens. Lui en faire le reproche serait plutôt malvenu. Je pense pourtant au très oublié George Catlin dont Charles Baudelaire a fait l’éloge. De Laure Carré, je pourrais écrire ce qu’il écrivait de lui à l’occasion du salon de 1846 : il « sait fort bien peindre et fort bien dessiner. » Les peaux-rouges qu’a peints Catlin me font songer aux cowboys que fait Carré – ou bien l’inverse. Peut-être parce que, dans un cas comme dans l’autre, la sûreté du dessin et la splendeur du coloris ressuscitent, avec délicatesse, cette sauvagerie primitive à laquelle, lui donnant une facture intemporelle et classique, puise toute peinture.
Je n’oublie pas les chevaux. Je devrais plutôt dire : les couples qu’ils forment avec leurs cavaliers. Tête-bêche, mêlant acrobatiquement leurs anatomies, absurdement unis, galopant parmi les plaines et au milieu des montagnes. Des centaures, si l’on veut. Le fil, la corde, le lasso dont je parlais, ce sont aussi les rênes à l’aide desquelles le cavalier dirige sa monture. Mais s’il les tient de la main gauche ou lui laisse la bride sur le cou- comme l’imaginait, il y a exactement un siècle, un poète surréaliste, Pierre Naville-, le destrier sur la selle duquel nous montons, il nous entraîne vers ce territoire du rêve dont procède et auquel conduit l’art de Laure Carré.
Philippe FOREST